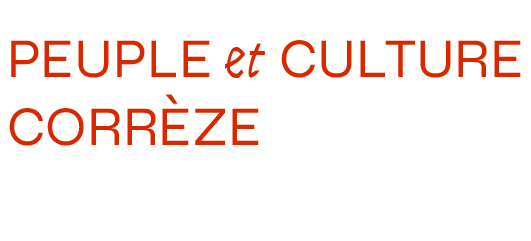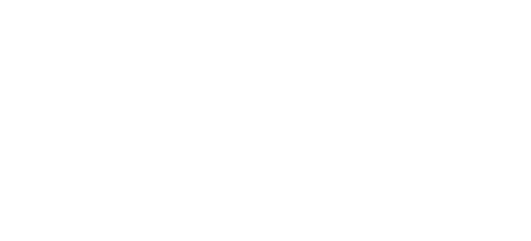Jean-François Chevrier et Élia Pijollet – « Hôtes (Titre provisoire) »
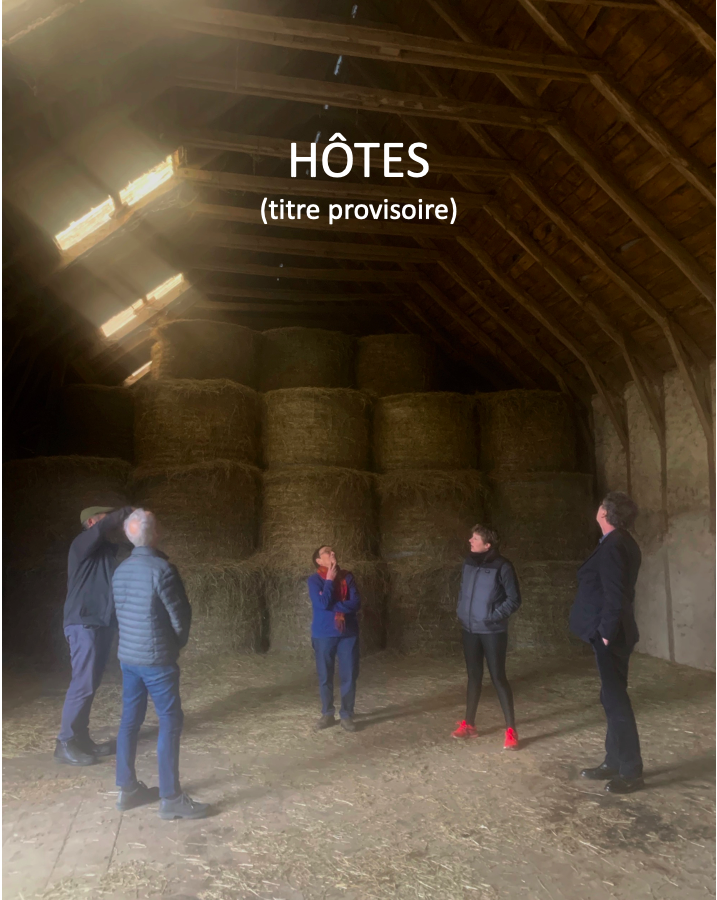
Tout territoire habité, tout « pays » forme une entité géographique complexe, qui peut constituer un matériau d’expérience(s). Cela vaut pour les individus comme pour les groupes qui l’habitent ou le visitent. L’action de Peuple et Culture Corrèze ne nous est pas inconnue. Nous (Jean-François Chevrier depuis 1998, Élia Pijollet depuis 2005) avons été amenés à collaborer à plusieurs reprises avec certain.e.s des artistes invité.e.s en résidence entre 1998 et 2014. Il s’agit aujourd’hui de réactiver cette expérience, en démultipliant l’idée même d’invitation ou de commande, tout en rendant publique notre manière de travailler. Nous voudrions faire jouer le double sens du mot « hôtes » en devenant ceux qui, accueillis, accueillent à leur tour. Nous envisageons un protocole qui permette de susciter à la fois observation, dialogues et interventions, en distinguant des phases ou étapes, documentées par un journal de bord.
En mars-avril 2025, lors d’un premier séjour de trois semaines à Tulle, une première étape de visites et rencontres nous a permis de mesurer les transformations récentes, plus ou moins visibles (ou visualisables), du territoire. Nous sommes revenus sur l’histoire des résidences organisées par PEC-Corrèze depuis 1995, dans l’idée de tisser une continuité. Une autre continuité s’établit naturellement avec le séminaire-forum « Des territoires » (1994-2004) aux Beaux-arts de Paris, fondé et animé par J.-F.C. Ce regard rétrospectif fait apparaître une durée et des écarts, notamment au travers des personnes qui ont été impliquées, ces trente dernières années, dans les activités et projets de PEC. Sans idéaliser ou dramatiser abusivement le passé, et en considérant dans sa vivacité l’expérience du présent, nous avons repéré quelques lieux clés et engagé des échanges qui vont se poursuivre dans les étapes suivantes.
Au cours de ces trois semaines se sont détachées des « situations » : un lieu, une ou des personne(s), un champ d’activité, traversés par une problématique (des idées générales) qui relie et ouvre à d’autres situations proches ou lointaines. Se sont dessinés aussi des champs d’action artistiques, à partir des relations que nous imaginons entre ces situations et les artistes que nous projetons d’inviter. Ces champs d’action présentent en eux-mêmes des relations ou interactions remarquables. Ils permettront de faire apparaître l’actualité possible de genres, disciplines et procédés artistiques aussi divers que la peinture (le tableau peint), la sculpture (objet-image et matériau), le duo photographie-dessin (le rapport document/illustration), la danse (ou la performance) et le récit. Nous comptons ainsi déployer l’idée de « paysage » dans son sens le plus large, incluant « pays » et « paysan.ne », expériences croisées de l’ici et des ailleurs.
D’ici la fin de l’année 2025, deux autres séjours de trois semaines (en mai-juin puis en septembre-octobre) seront consacrés à la mise en place des rencontres entre « situations » et artistes invité.e.s. La durée du séjour des artistes sera variable, en fonction de la répartition, pour le projet de chacun.e, entre travail sur place et travail au retour à l’atelier. Une part des travaux à venir sera documentaire (via la photographie, le dessin ou le texte) ; certains, notamment ceux liés à la danse, trouveront leur réalisation in situ ; certains encore feront l’objet d’ateliers de pratique partagée avec des habitant.e.s, via le réseau associatif et les établissements scolaires
Nous assumons la dimension expérimentale du projet, conciliant méthode et circonstances. Le temps que nous passerons sur place avec les artistes donnera lieu à des échanges d’idées et des rencontres élargies (entre artistes, entre artistes et acteur.rice.s du territoire), dont nous rendrons compte dans le journal de bord. Nous espérons pouvoir susciter chez les artistes invité.e.s une activité et une envie d’œuvre. Mais on peut imaginer que, si œuvre il y a, elle apparaisse avec retard et décalée par rapport au matériau observé sur place et même par rapport à la problématique qui sera apparue au cours de nos échanges. Le temps long du projet (mars 2025–2027) le permet. L’année 2026 sera le temps des approfondissements, reprises et prolongements, qui donneront lieu de nouveau à deux ou trois séjours, avec un.e ou plusieurs des artistes invité.e.s. Il s’agira alors de prolonger les réflexions, faire aboutir des processus, imaginer la restitution des travaux engagés.
Le fait que l’expérience se déroule sur deux années, avec la tenue du journal de bord, permet d’imaginer la constitution d’un ensemble de propositions articulées (œuvres et documents), sous la forme d’une publication et d’une exposition. Les séjours successifs permettront d’identifier le ou les lieu(x) d’exposition et de définir un cadre éditorial. Nous tenons aujourd’hui à laisser ces possibilités ouvertes pour les préciser au fil du travail. Il nous semble d’ores et déjà possible de penser à un scénario de musée d’art et de culture. Il en existe trop peu. La séparation des beaux-arts et des arts décoratifs (ou savoir-faire artisanaux) se perpétue, alors qu’il faudrait, plus que jamais, penser œuvre et activité, histoire et expérience, en favorisant les situations de participation et les voies obliques de l’imaginaire.
°°°°°°°°°°°
Chacun de nos séjours est également l’occasion d’une séance d’histoire de l’art ouverte à tou.te.s, au croisement de la vocation d’éducation populaire de PEC et des cours que J.-F.C. a donnés aux Beaux-arts de Paris tous les lundis de 1988 à 2019. La première s’est tenue le 2 avril dans les locaux de PEC à Tulle : Équilibre, « et qui libre ? », à partir d’une projection d’œuvres de Matisse, Paul Klee, Sophie Taeuber-Arp, Marcel Duchamp. J.-F.C a évoqué les reformulations de l’idée d’équilibre, souvent associée à la stabilité et à l’harmonie, par les artistes modernes, qui ont fait jouer ses limites et ont ouvert la question des relations entre équilibre et liberté. La deuxième aura lieu début juin.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Historien et critique d’art, Jean-François Chevrier a enseigné à l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris de 1988 à 2019.
Fondateur et rédacteur en chef de la revue Photographies (1982-1985), conseiller général pour la documenta X (1997), il est commissaire d’expositions indépendant depuis 1988. Ses recherches sur l’art moderne historique et actuel (photographie comprise), les échanges entre littérature et arts visuels, l’espace public et l’architecture, ont donné lieu à de nombreux essais, conférences, livres, expositions et à des collaborations avec des artistes très divers.
Dans le cadre de la préparation de la documenta X et en lien avec le séminaire Des territoires (créé et animé aux Beaux-arts de Paris, 1994-2008), il a mené diverses recherches et expérimentations pratiques sur la teneur documentaire de l’art, la présentation des œuvres d’art et la relation local/global dans l’expérience du territoire.
Entre 2010 et 2015, les Éditions L’Arachnéen ont publié une suite de sept livres, de La Trame et le hasard à L’Hallucination artistique. De William Blake à Sigmar Polke et Œuvre et activité. La question de l’art.
Élia Pijollet, après des études d’arts appliqués, d’esthétique et d’histoire de l’art (1989-1994), a travaillé au Frac des Pays de la Loire (1995-1999) puis avec divers artistes et éditeurs (2000-2005). Elle collabore avec Jean-François Chevrier depuis 2002, contribuant à divers titres à l’élaboration des expositions, ouvrages, conférences et projets muséographiques.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

L’art avec le temps, une conférence d’histoire de l’art par Jean-François Chevrier
Mercredi 4 juin – 18h30
A Peuple et Culture – 36 avenue Alsace Lorraine – Tulle
En partenariat avec la Cour des Arts
Apparue au début du 16e siècle dans un tableau du Vénitien Giorgione, la formule signifie que l’artiste qui se tourne vers les réalités terrestres doit composer avec le temps. Le temps est un fait d’expérience et une énigme. Il peut être rendu sensible par le mouvement mais ne s’y résume pas. Le romancier Joseph Conrad y a vu « l’élément destructeur », dans lequel est plongée une vie dès qu’elle advient. Au travers d’oeuvres de Carlo Carrà, Natalia Gontcharova, Duchamp, Magritte, Giacometti, nous verrons comment les protagonistes de l’art moderne ont fait jouer le facteur temps, ou la durée, entre le quotidien et l’histoire.
La séance sera suivie pour celles et ceux qui le souhaitent d’un repas partagé. Chacun-e- apporte du salé, du sucré ou du liquide à partager.