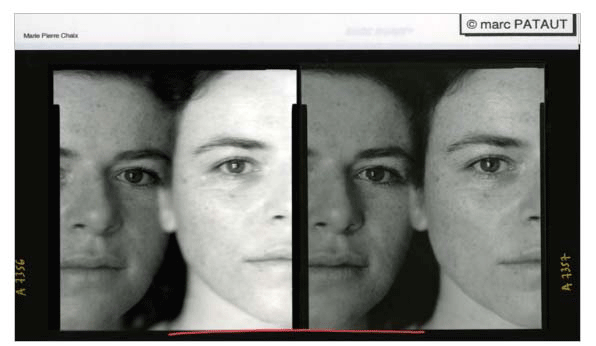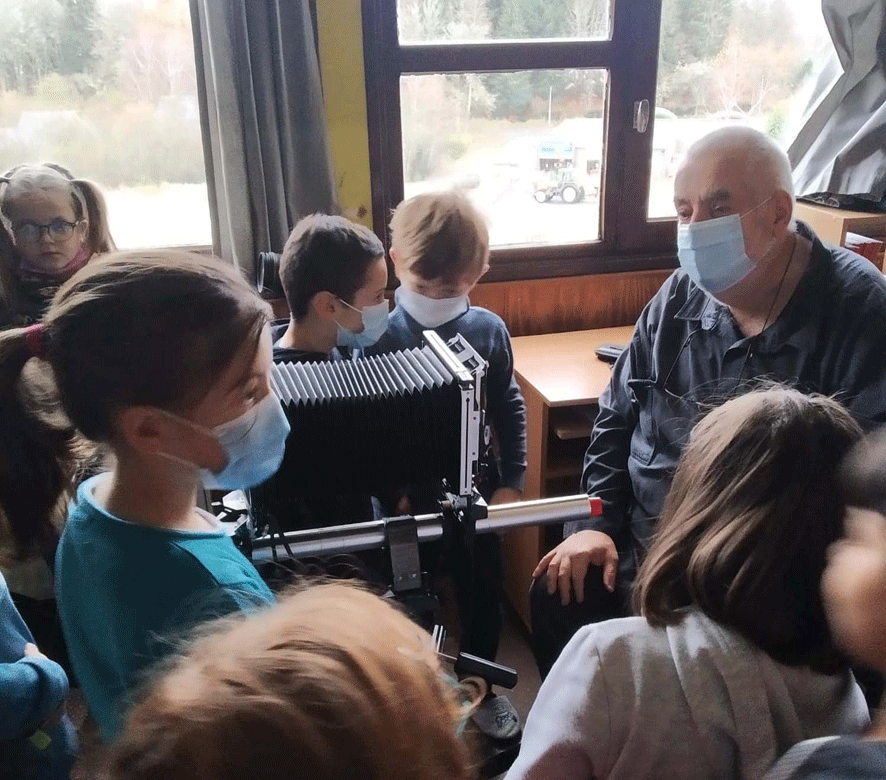
Marc Pataut (2021 – 2023)
Marc Pataut est photographe. C’est en suivant les cours du sculpteur Étienne Martin, à l’École Nationale Supérieure des Beaux-arts de Paris, au début des années 1970, qu’il choisit comme modèle « la sculpture contre la peinture ». C’est en faisant un reportage dans la campagne polonaise pour l’agence Viva au moment des émeutes de Gdansk (1980) qu’il renonce à devenir photographe de presse ; et en confiant des appareils de photographie aux enfants de l’hôpital psychiatrique d’Aubervilliers, en banlieue parisienne en 1981, qu’il comprend qu’il est possible de faire des images « avec le corps, et pas avec les yeux ». En un sens, tout est déjà là : l’échelle du corps, le refus du photojournalisme d’auteur à la Cartier-Bresson, le parti pris des fragiles, l’intuition de ce qu’on appelle faute de mieux « l’art en collaboration », dont il est l’un des précurseurs.
Tout est déjà là, et déplacé : faire de la photographie, mais selon le modèle de la sculpture, avec le corps ; faire de la photographie, mais aussi ne pas en faire, prendre le temps et courir le risque d’en faire avec d’autres, ou de la laisser faire par d’autres ; envisager la photographie comme une activité plutôt que comme une œuvre personnelle. Marc Pataut est né en 1952 : il fait partie de la génération des années 1970, mais il est silencieux et fidèle à ses origines populaires. Il a très vite compris qu’il détenait un pouvoir : celui de créer des situations et d’en faire surgir de l’art. Il pense son activité comme une série d’expériences qui visent à montrer que de l’art surgit à la condition qu’une rencontre ait lieu. Contre les hypothèses d’un art expérimental individuel, voire individualiste, il considère cette activité comme un « travail » (y compris au sens psychique, analytique). Il se donne des terrains : l’école, la rue, l’hôpital psychiatrique, un terrain vague habité par des sans-abris, une ville fantôme (désindustrialisée), l’ancien territoire agricole d’un asile, une zone rurale démembrée, une association de chômeurs ou de personnes en situation de grave précarité sociale et existentielle, tels sont les lieux apparemment impropres à l’art à partir desquels il entend faire surgir de la singularité et tirer des formes artistiques.
Les limites spatiales et les règles institutionnelles sont pour lui la condition pour que quelque chose ait lieu, pour que s’affirment des présences et qu’une ouverture se dessine. L’art, ici, agit comme une perspective commune, mais extérieure aux subjectivités en jeu ; il détourne des tentations fusionnelles et des « bons sentiments ». Idéalement : il entretient la visée politique de l’expérience. Les photographies, tantôt prises par lui et tantôt par d’autres, restent solidaires de la situation dont l’artiste est « l’inventeur ». Elles le restent dans leur mode de présentation. Marc Pataut hérite de l’histoire de l’art moderne : le montage (il a également pratiqué la vidéo) est la deuxième opération, après la prise de vues et avant l’exposition qui s’apparente à une mise en scène par le déploiement des figures dans l’espace.
Les tirages sont le plus souvent grands, associés et exposés pour rendre compte d’une expérience de perception qui adapte les principes de Josef Albers ou John Coplans (Emmaüs, Sortir la tête, Du Paysage à la Parole, Humaine). La série du Grand stade, tirée de deux années de visites aux sans-abris du terrain vague du Cornillon et exposée en 1997 à la Documenta X, consiste au contraire en quatre cents petits tirages, inspirés du lyrisme critique de Raoul Hausmann et exposés comme les pages d’un récit ou d’une partition (une fugue). Le musée est l’une des destinations de l’œuvre ; l’autre est l’espace public, la rue.
Au début des années 1990, il participe avec Gérard Paris-Clavel à la création de l’association de graphistes NE PAS PLIER : ses portraits d’anonymes sont portés dans les manifestations parmi les images et les slogans typographiés dans la grande tradition des mouvements d’agit-prop. Les activités de NE PAS PLIER sont exposées au Stedelijk Museum en 1995. L’œuvre de Marc Pataut est considérable. Quarante ans d’activité ont donné lieu à des milliers d’images soigneusement archivées par projet, et ont défini une pratique artistique absolument singulière, qui revendique les aspirations les plus puissantes et les plus émouvantes des mouvements d’éducation populaire. Éducation populaire au sens le plus fort et non dévoyé par la pseudo-démocratisation de la culture : celle qui croit dans l’art comme écart, pour le pouvoir qui est le sien de déplacer les individus des lieux où la société (et a fortiori la société néo-libérale) les assigne, quand elle les assigne quelque part (ailleurs que derrière des murs). Cette exigence l’a tenu à l’écart des lieux de consommation culturelle ou des lieux trop marqués par le strict engagement social.
Sandra Alvarez de Toledo

Près de vingt ans après l’exposition « Sortir la tête, Pays, paroles, images » aboutissement de trois années d’écoute photographique de Marc Pataut dans le pays de Tulle, qui fut présentée dans trois petites communes de Corrèze puis à l’Ecole supérieure des beaux arts de Paris, Peuple et Culture a souhaité le solliciter à nouveau alors que l’ensemble de ses travaux ont fait l’objet d’une rétrospective Reine Sofia à Madrid et au Jeu de Paume à Paris.
Sous forme d’enquête photographique, le projet en cours interroge les questions de la transmission et de ce qui fait ( ou ne fait pas ) lien dans un territoire, en l’occurrence la petite commune de Peyrelevade sur le plateau de Millevaches.
Les travaux de Marc Pataut se déroulent pour l’heure dans trois entités : l’école, le CADA et l’EPHAD.
École Bernard Coutaud de Peyrelevade
J’ai réalisé à l’école Bernard Coutaud de Peyrelevade, dans les classes d’Elsa Christophe et d’Aurore Baudino une série de portraits à la chambre photographique.
Impressionnant ce gros appareil photographique et son voile noir, chaque élève a pu observer l’image inversée qui se forme à l’arrière sur le dépoli. Ils sont venus ensuite par groupes de deux ou trois, poser, d’abord un portrait classique, puis avec l’idée de ribambelle en tête, ils ont posé pour un demi-portrait, afin de pouvoir raccorder ce demi-portrait droit et gauche à celui d’un camarade choisi par eux. Pendant que je réalisais les portraits, Charlotte Legrain réalisait avec eux des ribambelles en papier découpé. Ce travail à la chambre se fait en négatif noir et blanc, donc en analogique, pas de résultats immédiats, un long processus de développement puis de tirage nous oblige à laisser un long moment entre la prise de vue et son résultat. Ce temps est nécessaire techniquement, mais aussi, et surtout il permet à tous d’attendre, de penser, d’imaginer le résultat. Dans un second temps les enfants vont découvrir les images et commencer à jouer de leurs identités par associations de demi-portraits, déjà dans les petits groupes constitués pour la prise de vue ils s’étaient choisis. Nous ferons également un travail de peinture en continuant comme dans un cadavre exquis les demi-portraits photographiques par un dessin, une peinture…
J’ai demandé à chaque enfant de penser à un arbre remarquable, un arbre à secret, dans leurs jardins, le village, la forêt… Y penser sans le choisir trop vite, bien réfléchir, mais déjà un bananier m’a été proposé. Nous irons ensuite photographier et cartographier ces arbres, écrire leurs histoires. Charlotte qui m’accompagnait dans les prises de vue, m’a raconté qu’enfant, son père lui avait demandé de choisir un arbre à secrets, dans la forêt elle a choisi un bel arbre, majestueux avec une belle croix rose peinte sur le tronc… on devine la suite. C’est cet écart poétique que nous allons chercher et par capillarité nous interrogerons les parents et les grands[1]parents. Là se révèleront d’autres histoires du cœur entrelacé d’initiales au fait de résistance. La carte ainsi produite nous parlera de généalogies intimes, mais aussi collectives. Au café un consommateur m’a dit « il y a cent ans il n’y avait pas d’arbres ici », aujourd’hui la forêt est partout, elle suscite des débats, des combats. Venant de loin je ne connais pas cette forêt, elle me semble abimée, attaquée, j’aimerais comprendre mieux et lire dans le paysage, l’architecture ce qui persiste de l’avant forêt. Je voudrais comme cela, de proche en proche comprendre ce territoire, à partir des enfants explorer l’apprentissage, la transmission. Puis passer à la forêt, comprendre les enjeux, entre l’avant forêt et le tout forêt.



EHPAD Ernest Coutaud
A l’EHPAD, les prises de vue des personnes se sont accompagnées d’enregistrements de récits qui ont été
décryptés



Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile
Travailler le recto et le verso d’une image, je montre l’un et cache l’autre. Au recto ma culture, mon rapport aux autres, aux images (histoire de l’art, littérature…), au verso une « écoute active ». Comment rendre compte d’une autre culture dans sa propre culture ? Comment ne pas répondre simplement aux sollicitations d’un sujet dramatique et parfois spectaculaire, mais opter clairement pour une approche fondée sur l’expérience qui se forme dans la rencontre d’une actualité collective et d’histoires individuelles (celle de l’artiste comprise). De l’autre côté aussi, le demandeur d’asile, forcé à l’exil, en attente d’une reconnaissance du statut de réfugié, interrogé dans sa propre présence physique par la précarité de son statut administratif et social et la menace trop souvent accomplie d’être débouté de sa demande et relégué à une existence clandestine. En 1976, John Berger publie, chez François Maspero, avec le photographe Jean Mohr un livre intitulé Le septième homme, un livre d’images et de textes sur les travailleurs immigrés en Europe. Sur la une, une photographie déchirée, sur la deuxième page de couverture, on peut lire : LA PHOTO COUPÉE. Ils étaient conduits dans les montagnes juste de l’autre côté de la frontière et abandonnés là. Totalement désorientés, certains mouraient de faim et de froid, d’autres faisaient demi-tour. Aussi les émigrants imaginèrent un système pour se protéger. Avant de partir, ils faisaient faire des photos. Ils coupaient la photo en deux, en donnaient une moitié à leur « guide » et gardaient l’autre. Quand ils atteignaient la France, ils renvoyaient leur moitié à leur famille, pour montrer qu’ils avaient bien franchi les frontières sains et saufs ; le « guide » allait voir la famille avec sa moitié de photographie pour prouver qu’il était bien celui qui les avait escortés, et c’était seulement alors que la famille payait la somme fixée. Plus loin dans le texte, on peut lire : Être sous-développé, ce n’est pas simplement être volé ou exploité : c’est être maintenu dans l’étreinte d’une stagnation artificielle. Le sous-développement ne fait pas que tuer. La stagnation, qui est son essence, nie la vie et ressemble à la mort. Le migrant désire vivre. Ce n’est pas la seule misère qui le force à émigrer. Par son effort individuel, il essaie de créer une dynamique absente du milieu où il est né.